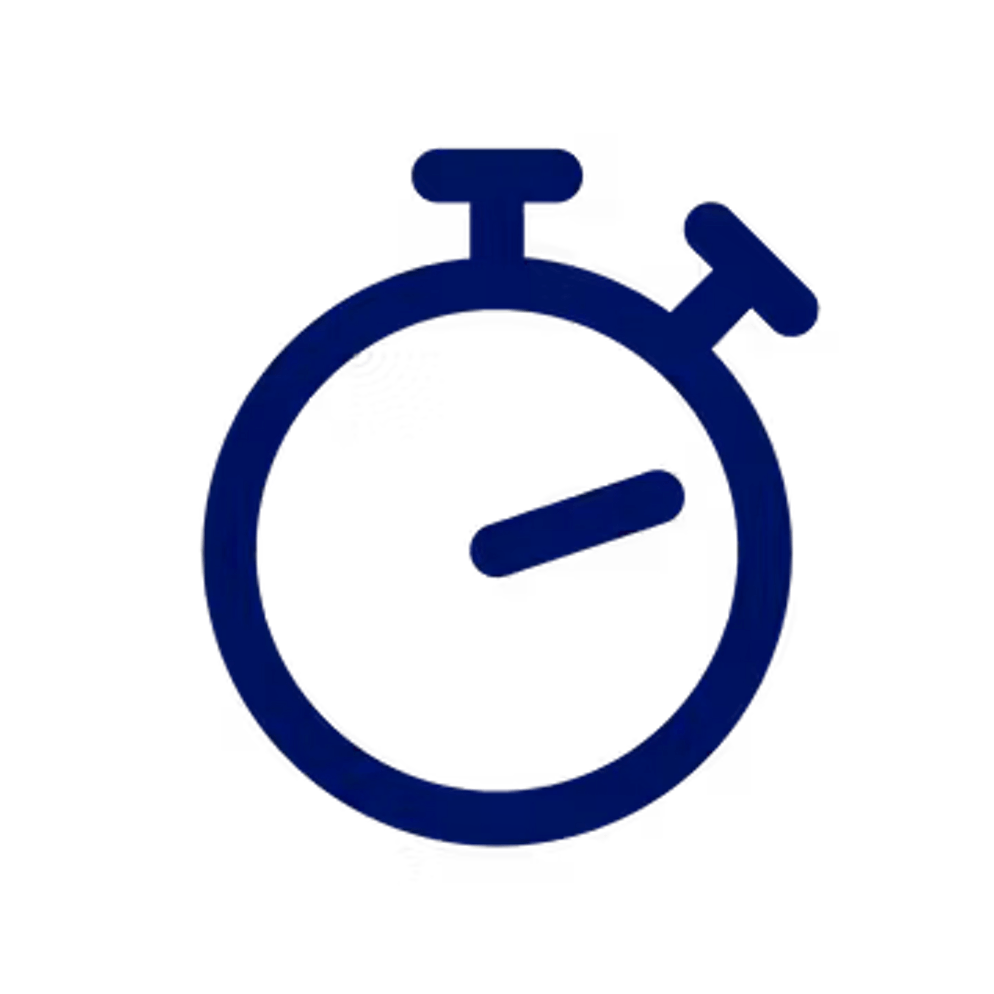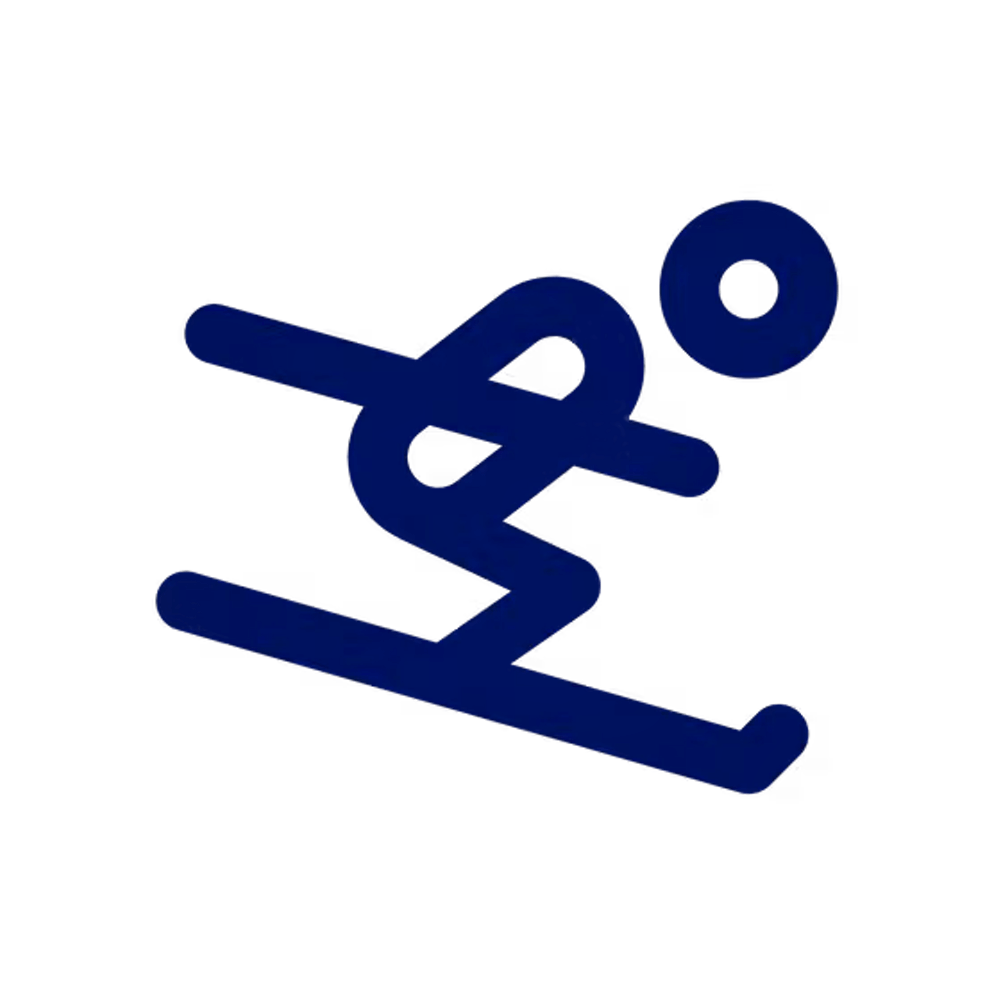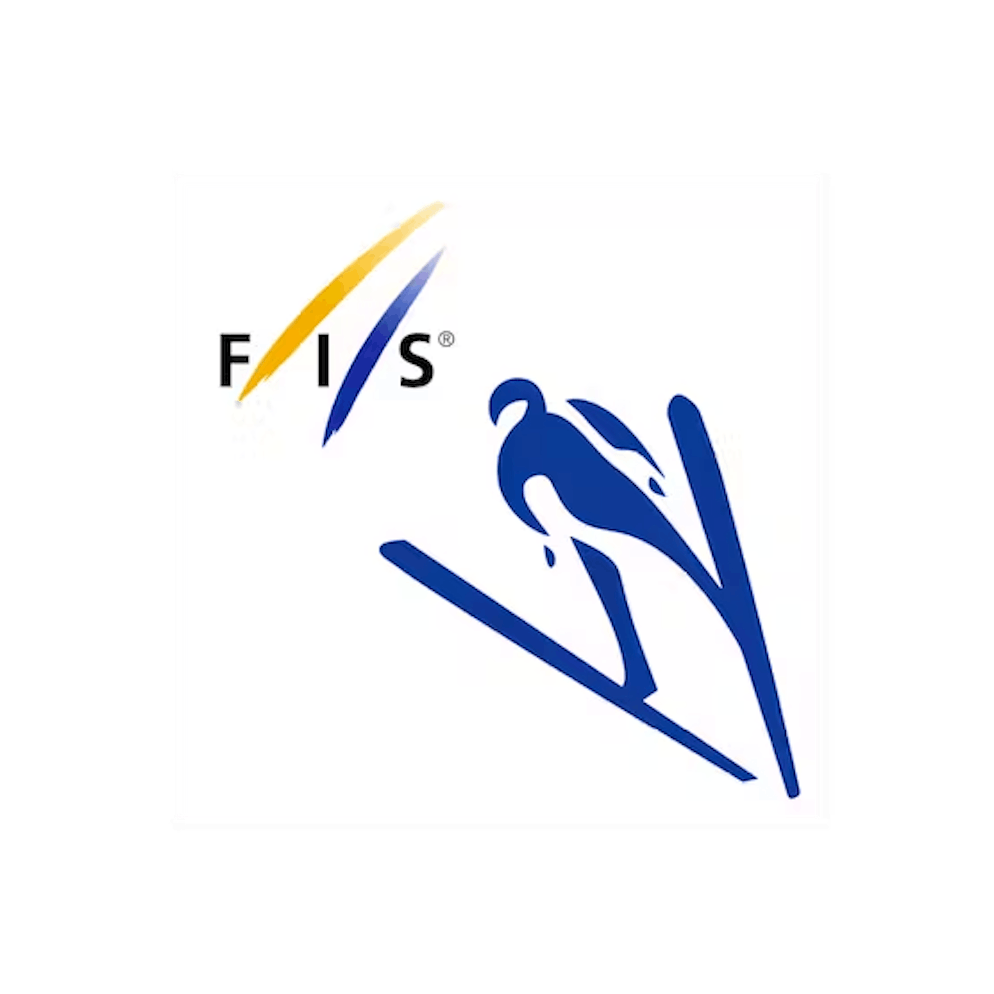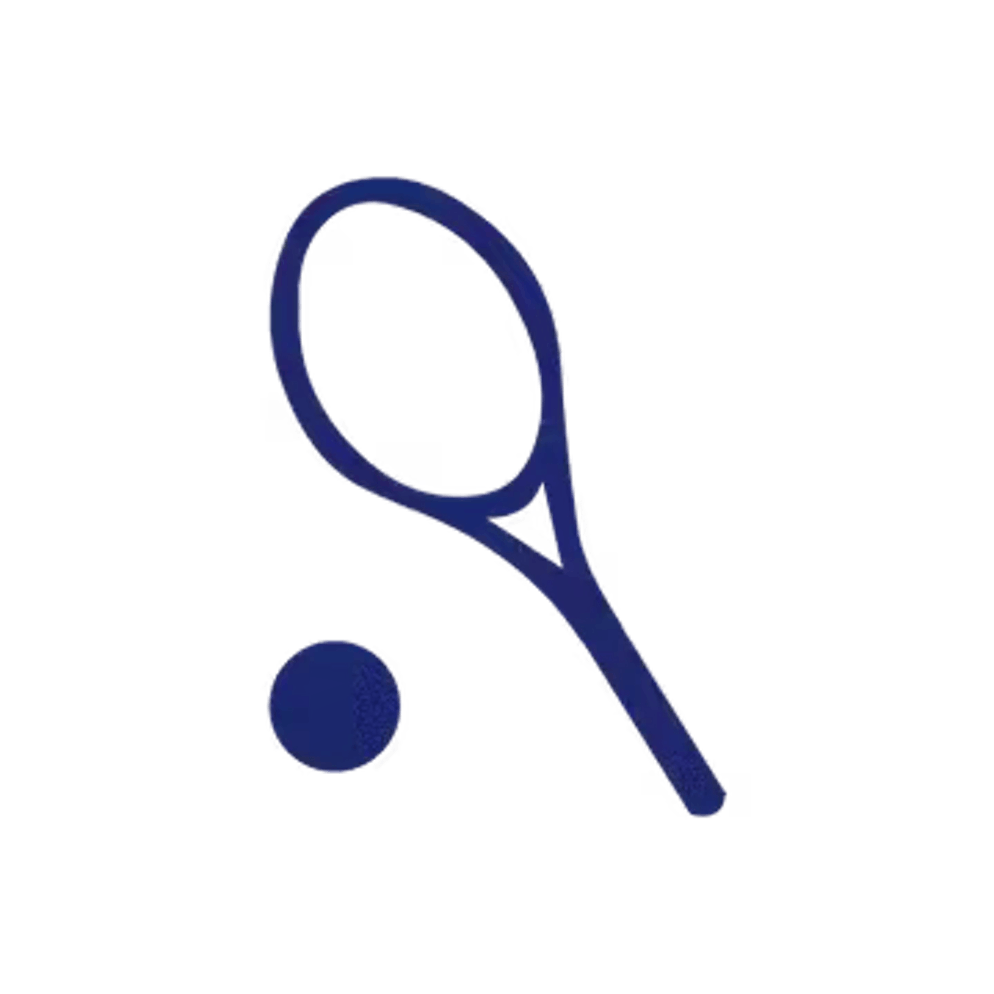A 102 ans, Mélanie Berger-Volle portera la flamme olympique aussi haut que possible, malgré son épaule fragile, au nom de l'amitié entre les peuples, une valeur qu'elle a défendue pendant la Résistance.

«Femme de l'ombre» durant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, elle n'en revient toujours pas d'avoir été choisie par le département de la Loire et la mairie de Saint-Etienne, dans le centre de la France, pour cette étape de la flamme, le 22 juin, avant les Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre) de Paris.
Si le poids de la torche l'inquiète un peu, il n'était pas question de refuser : «j'ai toujours aimé le sport», explique avec vivacité cette femme fluette, qui jusqu'à peu pratiquait une heure de marche quotidienne.
Grand-mère de la gymnaste Emilie Volle, qui a participé aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996, elle veut aussi être un symbole pour les femmes «qui se sont battues pour faire du sport comme les hommes».
«Mon idéal a toujours été d'unifier le monde», confie la centenaire. «Et les olympiades sont un moment formidable pour faire connaissance avec d'autres êtres humains».
Née en Autriche en 1921 dans une famille ouvrière juive, Mélanie Berger commence à militer dès l'adolescence dans un groupe d'extrême gauche. «On était athée et quand j'ai commencé à lutter, ce n'était pas pour des motifs religieux, c'était politique», souligne-t-elle. «Je suis contre toutes les dictatures.»
Après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en 1938, elle quitte son pays, passe en Belgique et arrive en France, à Paris au printemps 1939, déguisée en garçon.
«Maltraitée»
Quand la France entre en guerre, tous les Autrichiens, même réfugiés, sont perçus comme des ennemis et les autorités la mettent dans un train en direction d'un camp dans le sud-ouest du pays.
En gare de Clermont-Ferrand (centre), elle saute du wagon ; les autres filles n'osent pas la suivre. «Elles n'étaient pas politiques, elles ne savaient pas ce qu'était un camp». La jeune militante sait, au contraire, que «quand on a une chance, il ne faut pas la laisser passer.»
En 1940, elle se retrouve dans le Sud-Ouest, à Montauban, où un groupe de militants trotskistes dont elle faisait partie avant la guerre commence à se reformer. «Avec mon nom à consonance française, j'ai loué un appartement dans une maison délabrée et on a pu commencer le travail».
Le groupe rédige et distribue des tracts en langue allemande destinés à retourner les soldats du Reich.
Mais elle est arrêtée en janvier 1942. Pendant les séances d'interrogatoire, «j'ai été maltraitée, des hommes m'ont battue», raconte-t-elle avec pudeur. «J'en ai gardé des séquelles, mais je suis encore là !»
Après 13 mois de détention à Toulouse, au sud de Montauban, elle est transférée à la prison de Marseille (sud-est).
«Non» au nazisme
Le 15 octobre 1943, des camarades viennent la chercher, accompagnés d'un soldat allemand gagné à la cause, alors qu'elle est hospitalisée pour une jaunisse. «Je me suis évadée en chemise de nuit», dit-elle en riant encore.
Une fois remise, elle milite jusqu'à la Libération sous de fausses identités.
Après la guerre, elle épouse Lucien Volle, lui aussi résistant. Ensemble, le couple commence à se consacrer au travail de mémoire.
«Nous avons lutté continuellement pour expliquer, pas ce qu'on avait fait, mais pourquoi on l'avait fait», souligne Mélanie Volle-Berger.
Elle a depuis obtenu de multiples décorations, dont la Légion d'honneur. «Je n'ai pas fait grand-chose», estime-t-elle pourtant. «Mais j'ai dit +non+» au nazisme.
Aujourd'hui très inquiète du retour des extrêmes en Europe, elle espère que les jeunes sauront à leur tour défendre la démocratie. Et malgré son grand âge, elle entend profiter des JO pour faire résonner son message. «Je voulais changer le monde et je veux toujours le changer».