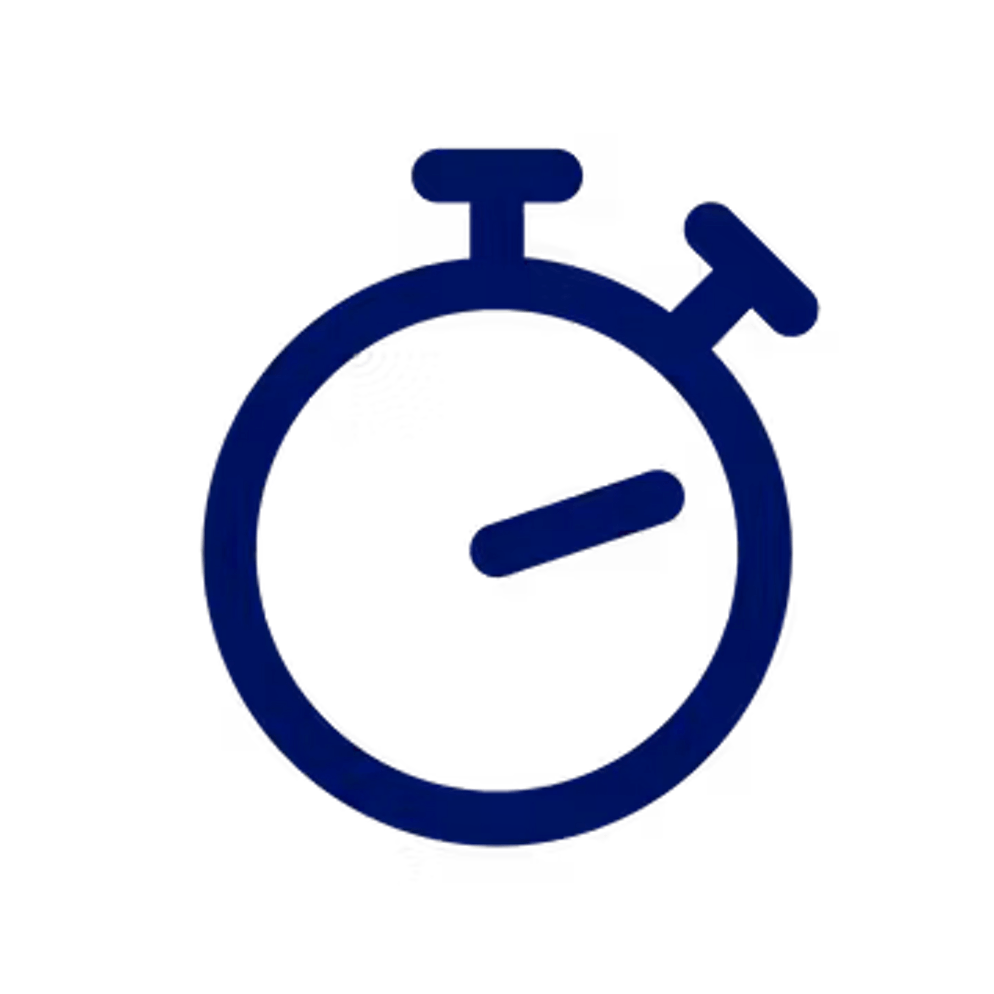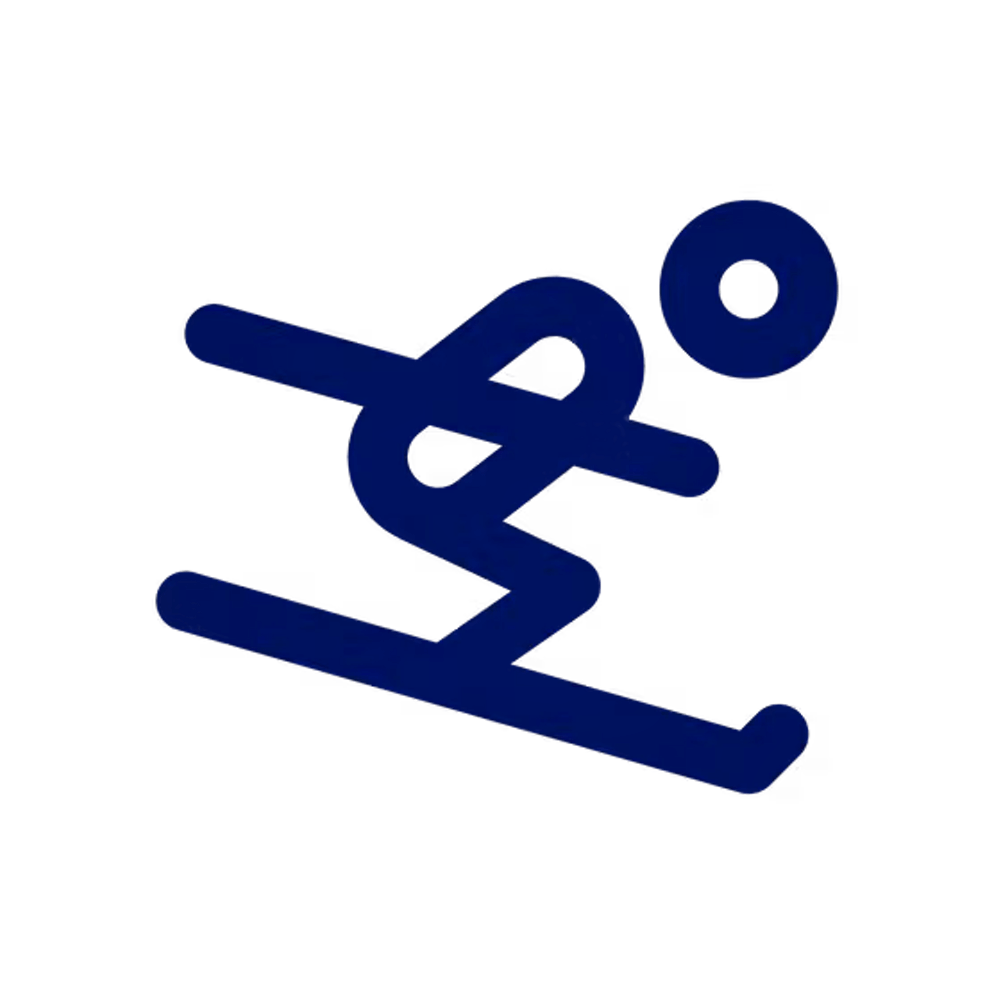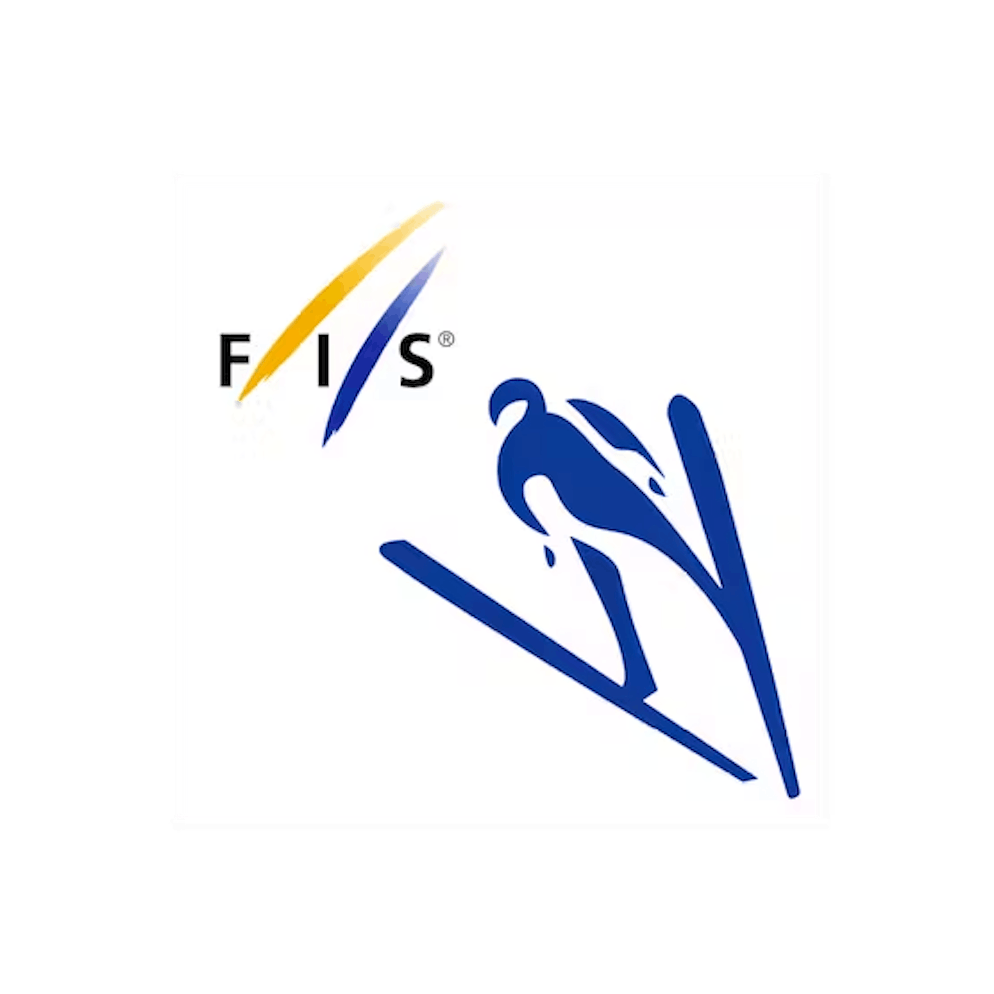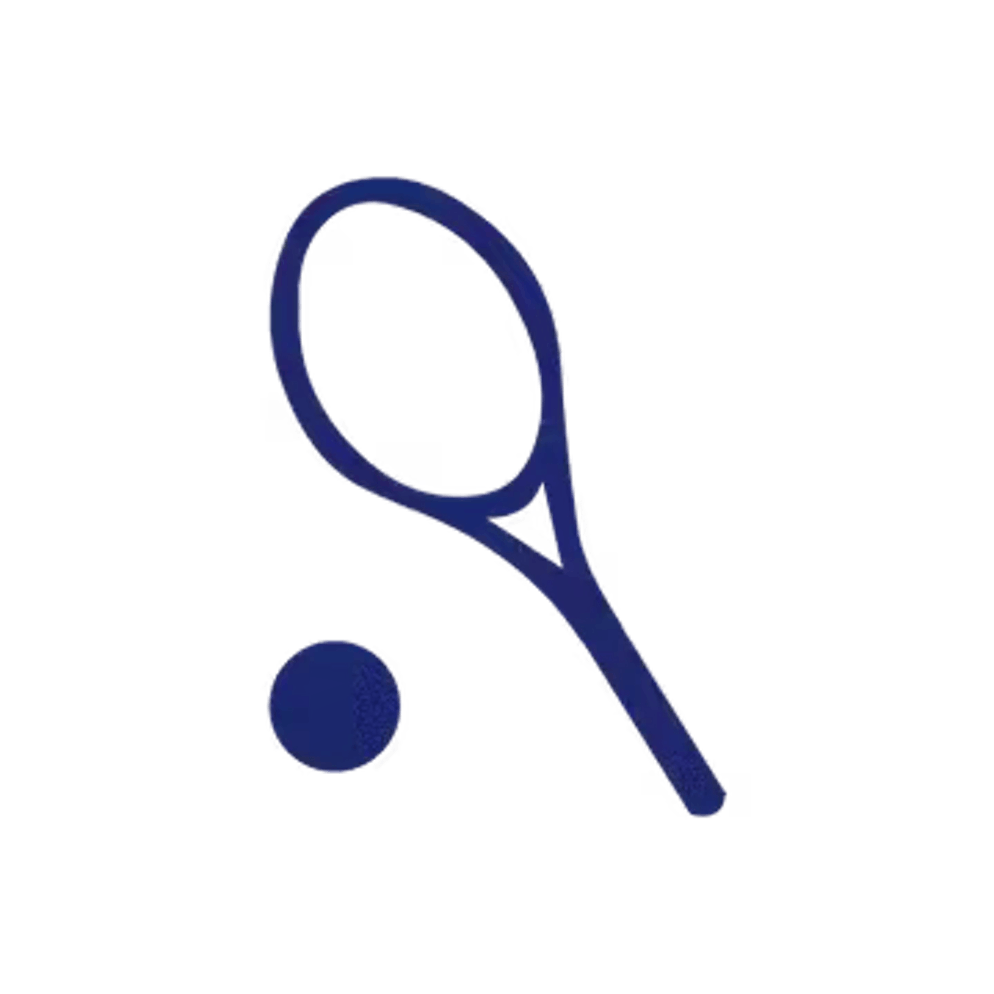Vincenzo Nibali est le dernier Italien à avoir remporté le Tour de France, en 2014. «Quand tu gagnes le Tour, tu comprends la grandeur de cette épreuve», explique-t-il, à quelques jours du départ de l'édition 2024 dans son pays, samedi à Florence.

Vincenzo Nibali, il y a dix ans, vous remportiez le Tour de France 2014, quel souvenir en gardez-vous ?
«C'est bien sûr un souvenir merveilleux, pas seulement parce que j'ai gagné. Je mets cette victoire au même niveau que ma première participation au Tour de France, que tout ce que j'ai vécu sur cette course, il y a l'arrivée sur les Champs-Élysées, l'enthousiasme du public au bord des routes, la beauté de Paris, c'était vraiment quelque chose de spectaculaire».
Vous êtes l'un des sept coureurs dans l'histoire du cyclisme à avoir remporté les trois Grands Tours, quelle est à vos yeux la plus importante de vos victoires ?
«Comme je suis Italien, clairement ma première victoire dans le Giro (ndlr: 2013, 2016 pour la seconde) est celle qui me tient le plus à coeur. C'était vraiment quelque chose que je désirais. Après ma victoire dans la Vuelta (ndlr: 2010), je ne me rendais pas vraiment compte de ce que j'avais accompli, il m'a fallu du temps pour la digérer et pour regagner ensuite un Grand Tour. Ma carrière a été marquée par une progression constante, d'abord le Tour d'Espagne, ensuite le Tour d'Italie et enfin le Tour de France. Quand tu gagnes le Tour de France, tu comprends la grandeur de cette épreuve. Mais là aussi, c'est une victoire que j'ai eu du mal à digérer: elle m'a donné une visibilité énorme, c'était un grand succès pour moi, mais mentalement, j'ai souffert après, c'était accablant.»
Dix ans après votre succès dans le Tour de France et huit ans après votre second Giro, l'Italie attend toujours votre successeur, pourquoi ?
«Il y a beaucoup de raisons, pas une seule. En Italie, comme ailleurs, les coûts dans le cyclisme ont augmenté. Je ne parle pas seulement des équipes World Tour, mais aussi des clubs, ce qui a conduit à la disparition d'un certain nombre d'entre eux. Il faut relancer le cyclisme au niveau des enfants, des jeunes et là on pourra trouver «LE» champion. Le cyclisme, c'est aussi beaucoup internationalisé, ce n'est plus un sport européen comme avant, où il n'y avait que la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas. Le niveau est toujours plus élevé, il est maintenant plus difficile de percer pour un coureur italien (...) Je pensais que quelqu'un comme Fabio Aru (ndlr: vainqueur du Tour d'Espagne 2015) pouvait reprendre le flambeau, mais il a arrêté tôt (ndlr: à 31 ans en 2021), il était cramé. C'est ce qui se passe dans le cyclisme moderne: de nombreux managers d'équipe cherchent à avoir un coureur prêt déjà à 21-22 ans, perdant peut-être de vue un athlète qui pourrait avoir une croissance beaucoup plus progressive.»
Tadej Pogacar réalisera-t-il cet été le doublé Giro/Tour de France, 26 ans après Marco Pantani ?
«C'est très possible, comme Jonas Vingegaard pourra le viser lui aussi dans le futur. Le cyclisme est devenu tellement technologique, tout est calculé en amont avec des instituts de recherches universitaires, dès la préparation d'avant-saison, la nutrition, le vélo, le maillot, le casque. Les gains marginaux sont devenus fondamentaux.»
Que vous inspire cette génération des Pogacar, Vingegaard, Van der Poel et Evenepoel qui gagne sur tous les terrains ?
«Elle t'oblige à regarder les courses dès le départ, car si tu allumes ta télé à 80 km de l'arrivée, il est fort possible que les jeux soient déjà faits. C'est sympa à suivre... Quand je suis passé professionnel, j'avais plus ou moins leur façon de courir en attaquant immédiatement, avec les années, j'ai changé ma façon de faire. C'est ce qu'on fait en amateur, eux ont gardé ce style de course en poussant par ailleurs la professionnalisation à l'extrême».