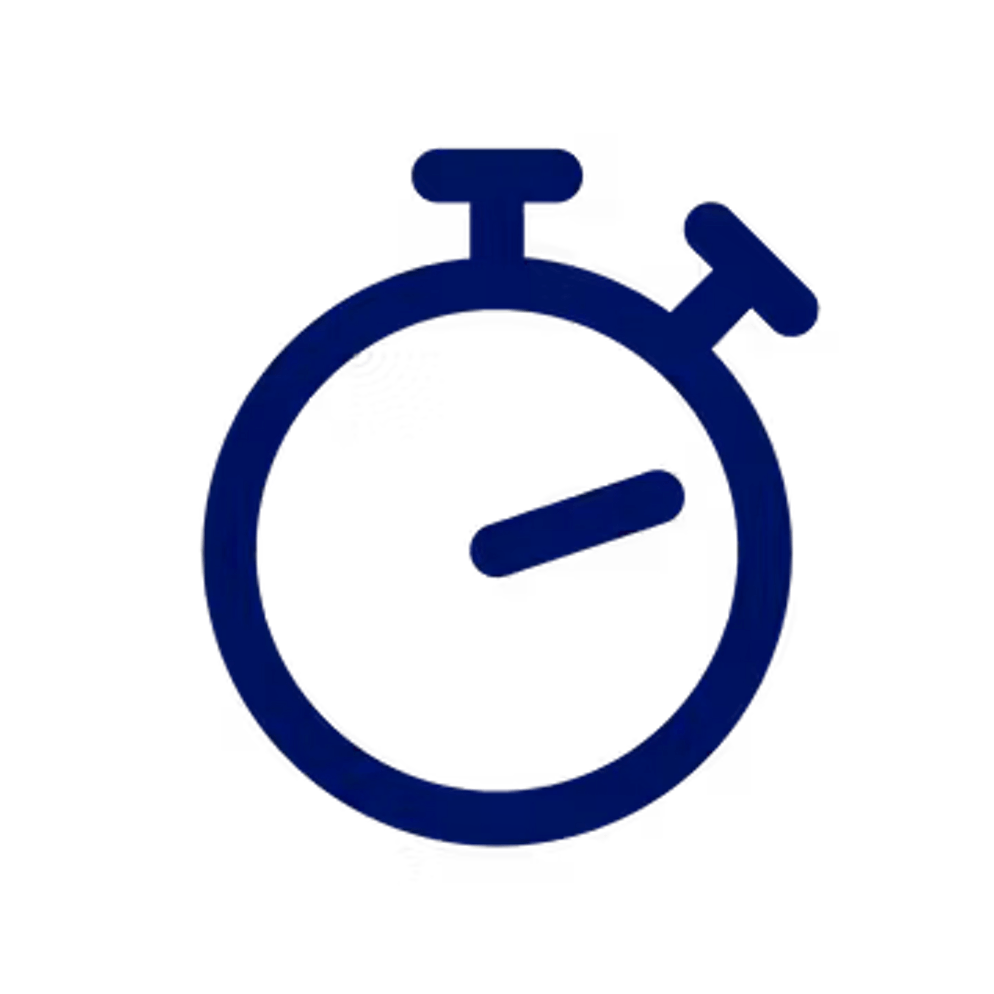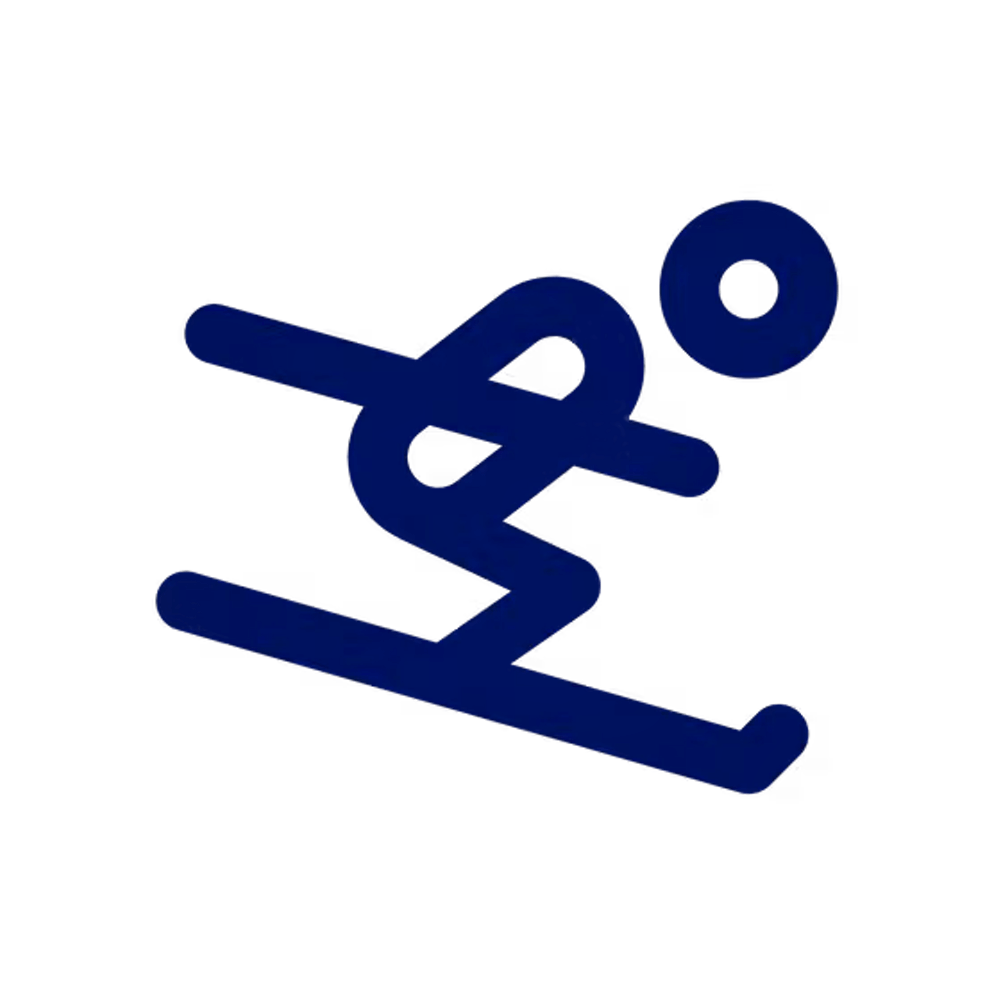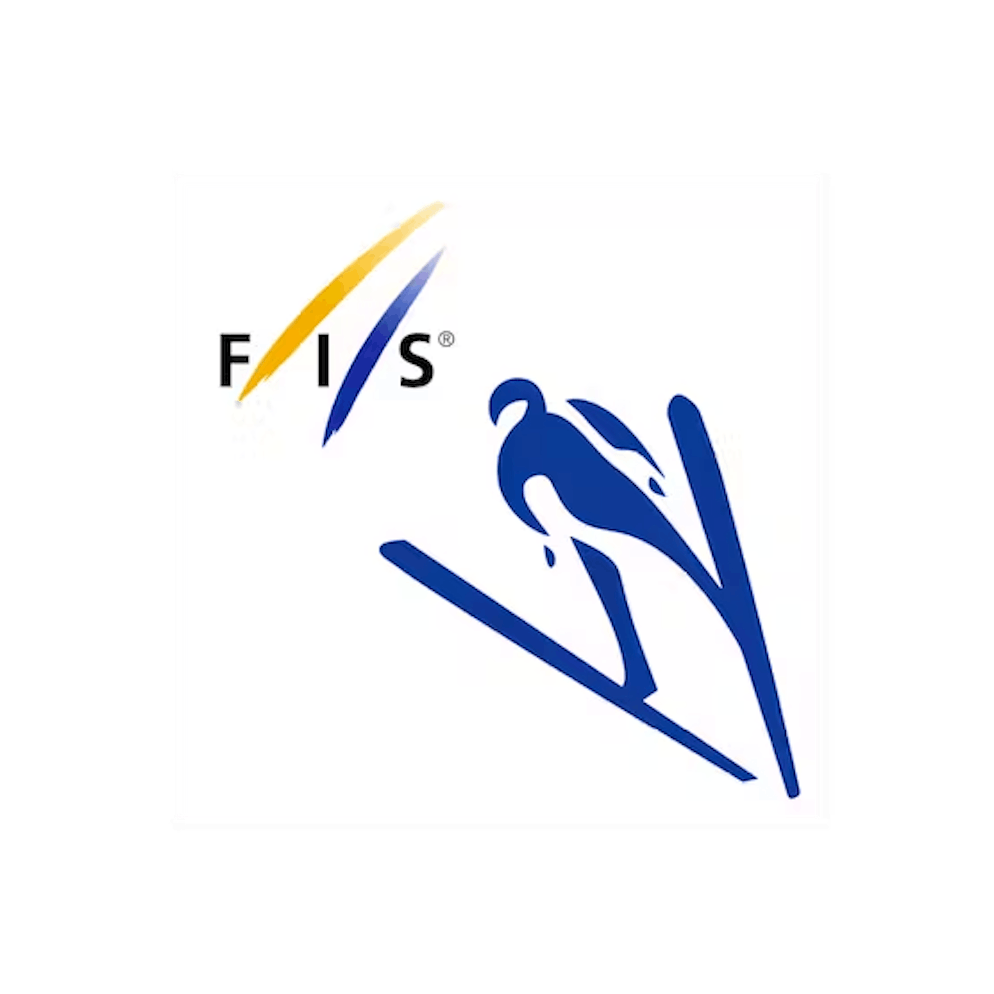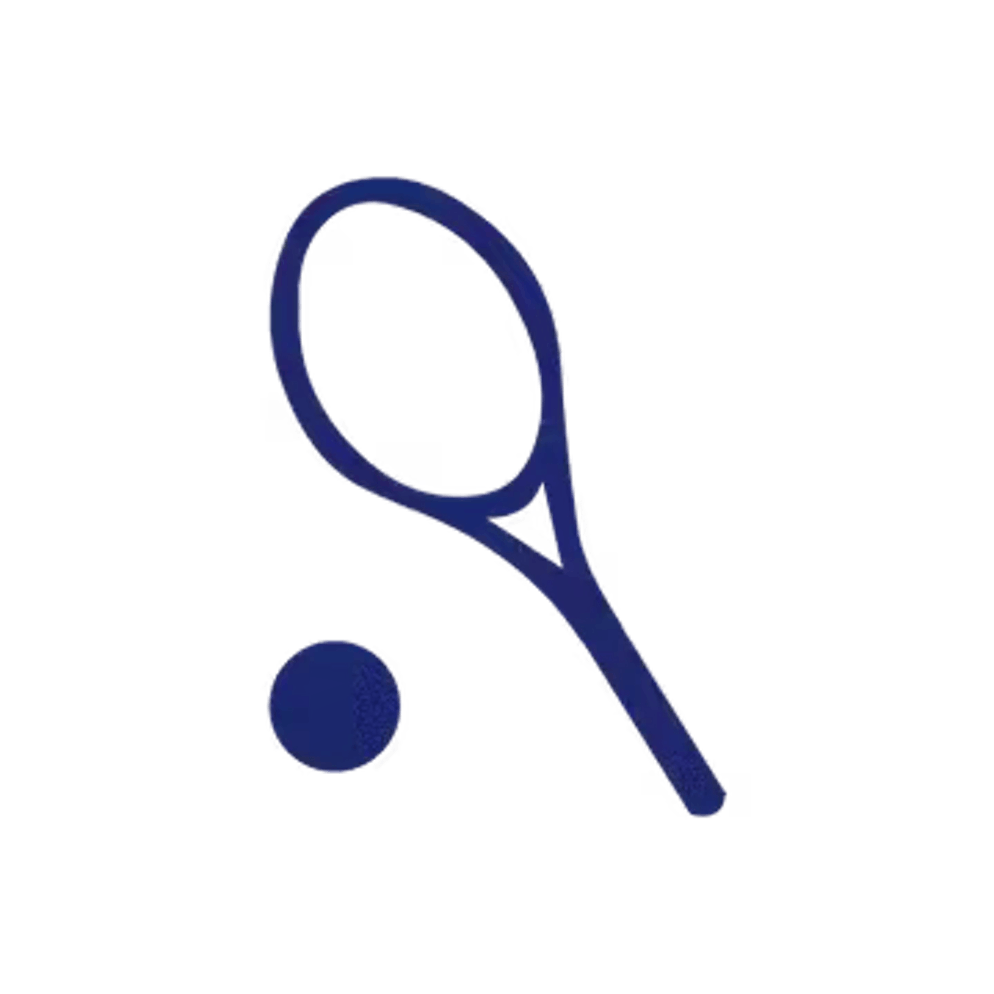Mattia Capezzoli, réalisateur de la RSI, s'est rendu en Ukraine. À son retour, il nous raconte sa première expérience en tant que correspondant de guerre, énumère les difficultés qu'il a dû surmonter sur le terrain, partage les sentiments qu'il a vécus, explique pourquoi il est important d'aller dans les zones de conflit et quelle est la clé pour produire un journalisme de qualité.
Mattia Capezzoli, Place Maïdan, Kiev
Les missiles russes ont touché un dépôt de carburants très près de la ville de Lviv le 26 mars.
Mattia Capezzoli filme Emiliano Bos, le collègue journaliste qui est en train de raconter l'un des bombardements près de Lviv.
Les réfugiés a l'arrivée à Lviv.
Les tentes à Lviv pour donner un premier accueil aux gens en fuite du reste de l'Ukraine.
Le voyage pour Kiev a été l'un des moments les plus chargés de tensions. À gauche Oleg Burkot (interprète) et à droite Emiliano Bos.
Le centre ville de Kiev vide.
Mattia Capezzoli en train de tourner des images pour l'un des reportages diffusés à la RSI.
Tous les moments sont à exploiter. Pendant l'un des nombreux déplacements, Mattia Capezzoli (à gauche) est en train de monter un reportage, pendant que le collège Emiliano Bos écrit les textes pour les commentaires.
Emiliano Bos devant la caméra de Mattia Capzzoli, à Kiev.
Avoir un équipement léger mais fonctionnel est capital pour bien faire son travail sur le terrain.
Mattia Capezzoli (ici sur la Place Maïdan): «La ville de Kiev est vide, que des soldats et des journalistes».
Parfois il y a eu l'occasion de réaliser aussi des interviews dans des endroits pas encore touchés par le conflit.
Les funérailles de trois soldats près de Lviv sont une des expériences qui ont plus marqué Mattia Capezzoli.
Pour livrer un produit journalistique de qualité depuis un pays en guerre bien s'entendre entre collègues est fondamental selon Mattia Capezzoli.
Mattia Capezzoli - correspondant de guerre RSI
Mattia Capezzoli, Place Maïdan, Kiev
Les missiles russes ont touché un dépôt de carburants très près de la ville de Lviv le 26 mars.
Mattia Capezzoli filme Emiliano Bos, le collègue journaliste qui est en train de raconter l'un des bombardements près de Lviv.
Les réfugiés a l'arrivée à Lviv.
Les tentes à Lviv pour donner un premier accueil aux gens en fuite du reste de l'Ukraine.
Le voyage pour Kiev a été l'un des moments les plus chargés de tensions. À gauche Oleg Burkot (interprète) et à droite Emiliano Bos.
Le centre ville de Kiev vide.
Mattia Capezzoli en train de tourner des images pour l'un des reportages diffusés à la RSI.
Tous les moments sont à exploiter. Pendant l'un des nombreux déplacements, Mattia Capezzoli (à gauche) est en train de monter un reportage, pendant que le collège Emiliano Bos écrit les textes pour les commentaires.
Emiliano Bos devant la caméra de Mattia Capzzoli, à Kiev.
Avoir un équipement léger mais fonctionnel est capital pour bien faire son travail sur le terrain.
Mattia Capezzoli (ici sur la Place Maïdan): «La ville de Kiev est vide, que des soldats et des journalistes».
Parfois il y a eu l'occasion de réaliser aussi des interviews dans des endroits pas encore touchés par le conflit.
Les funérailles de trois soldats près de Lviv sont une des expériences qui ont plus marqué Mattia Capezzoli.
Pour livrer un produit journalistique de qualité depuis un pays en guerre bien s'entendre entre collègues est fondamental selon Mattia Capezzoli.
Mattia Capezzoli, comment et quand avez-vous décidé de devenir correspondant de guerre?
Le 10 mars, on m'a proposé d'aller en Ukraine. Je n'avais aucun doute, j'ai immédiatement décidé de partir. Avec mon collègue, le journaliste Emiliano Bos, en 24 heures, nous avons organisé le matériel nécessaire et traité les procédures administratives. Nous sommes partis le 12.
Pourquoi avez-vous accepté tout de suite? Après tout, vous partiez pour entrer dans un pays en guerre, pas pour un reportage normal.
Dans mon travail de réalisateur, j'essaie de tout prévoir, y compris les imprévus, et de planifier le plus possible. Dans un pays en guerre, cela devient très compliqué. En ce sens, il y a eu effectivement un sentiment d'incertitude. Mais j'ai accepté parce que cela fait partie de mon travail et je pense qu'il est très important que les envoyés se rendent là où les choses se passent pour les raconter, surtout en cette période, où il y a une tendance croissante à juger et à tirer des conclusions à plusieurs kilomètres de distance, sans être correctement informé. Il est essentiel que vous vous y rendiez pour être témoin de ce qui se passe.
De quel matériel vous avez eu besoin, à part, bien sûr, les caméras?
Les critères fondamentaux pour affronter votre travail dans un climat hostile et imprévisible comme celui d'une zone de guerre sont deux : la flexibilité et la sécurité. En ce sens, il est important d'apporter avec vous un équipement léger et fonctionnel par rapport à ce que vous vous attendez à trouver sur le terrain. En même temps, des solutions de secours doivent toujours être prévues en cas de problème. Par exemple, j'ai toujours eu trois téléphones avec moi, suffisamment de batteries pour assurer une autonomie énergétique susceptible de faire face aux imprévus. Évidemment, un gilet pare-balles, un casque et une petite pharmacie sont indispensables.
Le réalisateur Mattia Capezzoli

Mattia Capezzoli
Mattia Capezzoli, né en 1987, s’est diplômé en 2013 au British Columbia Institute of Technology à Vancouver en Broadcast Communication, Television & Video Production. Il a commencé à collaborer avec RSI en 2008 et est fixe depuis 2013. Au sein de RSI, il s'occupait d'émissions d'information, de divertissement et culturelles. Il a été envoyé en Norvège pour couvrir les attentats terroristes d'Oslo et d'Utøya en juillet 2011, en Éthiopie et à Bondo en 2017 pour le glissement de terrain. Il a notamment réalisé deux émissions en direct, «Gottardo 09:39», 20 ans après l'accident du Gothard, puis «TuttInsieme 2022», pour le réveillon. Il s'occupe maintenant de la réalisation des programmes culturels et d'actualité.
Vous avez passé quelques jours à Lviv, la ville la plus à l'ouest de l'Ukraine, carrefour entre ceux qui fuient l'horreur et ceux qui partent au front pour se battre. Quelle a été la première impression?
Le sentiment que nous avons eu, une fois arrivés là-bas, c'est qu’aucun lieu n'est sûr. Lviv n'est pas sur la ligne de front. Pourtant le jour de notre arrivée (le 13 mars, ndlr) des bombes sont tombées à 40 kilomètres de là. Le 18 mars, trois missiles russes en provenance de la mer Noire ont touché un entrepôt près de l'aéroport. Quelques jours plus tard, il y a eu un troisième attentat, cette fois en pleine ville, à trois kilomètres du centre. Dans ces deux derniers cas, nous nous sommes rendus sur place pour documenter ce qui se passait.
Alors avez-vous eu peur?
Non. Je n'utiliserais pas ce terme. Il y a une composante de risque qui est acceptée, parce qu'il est clair qu'on est dans une zone de guerre. Les sirènes sonnent quatre ou cinq fois par jour, ainsi que la nuit. Les gens se promènent dans les rues et dans les bars. Mais tout le monde est bien conscient qu'on n'est pas en sécurité, qu’on n’est pas dans une bulle.
En plus des explosions, vous avez documenté autre chose.
Oui, nous avons parlé de trains, trois ou quatre par jour, arrivant de toute l'Ukraine, pleins de gens en fuite. Les autorités remplissaient les convois à la limite du possible, peut-être même au-delà, il n'y avait pas besoin de billet. Nous avons surtout vu des femmes et des enfants. Certains d'entre eux nous ont dit qu'ils étaient sur la route depuis trois jours.
Vous êtes ensuite allé jusqu'à Kiev, alors que les troupes russes n'avaient pas encore commencé à se retirer.
Dans un environnement hostile comme celui d'un pays en guerre, tous les mouvements sont soigneusement planifiés, évalués et pondérés. On n'improvise jamais et quoi que l'on décide de faire, il faut toujours planifier un plan B et aussi un plan C. Après quelques jours à Lviv, nous avons estimé - en accord avec nos supérieurs - que la situation à Kiev comportait un degré de risque raisonnablement acceptable. Faire ce type d'évaluation n'est possible que lorsque vous êtes sur le terrain.
Avec quel moyen êtes-vous arrivé dans la capitale?
Nous sommes allés à Kiev en train. Ce fut l'un des moments les plus tendus. Nous sommes partis tard le soir et avons voyagé de nuit, plongés dans le noir, même dans le wagon pour des raisons de sécurité, au milieu d'un pays en guerre que nous ne connaissions pas, sans savoir exactement où nous étions. L'expérience vécue contrastait alors avec ce que nous avions vu jusqu'alors, avec les wagons débordant de monde. Nous nous sommes pratiquement retrouvés dans un train vide. Avec nous, il n'y avait que quelques médecins, avocats, diplomates et autres collègues journalistes.
Avec des avocats?
Oui, plusieurs ONG et autres organisations commerciales internationales emploient des avocats pour documenter ce qui se passe en Ukraine. Nombre de ces organisations sont actives dans la défense des droits de l'homme et dans la documentation des crimes de guerre.
Êtes-vous partis seuls pour Kiev?
Non. Nous étions accompagnés de notre interprète, qui a temporairement déménagé à Lviv, mais qui vit à Kiev. Avant de partir, nous avons pris contact avec des fixers qui sont sur place depuis un certain temps, pour comprendre quelles zones éviter et lesquelles nous aurions pu atteindre en maintenant un niveau de risque acceptable. Il est essentiel de pouvoir compter sur des personnes qui connaissent la situation en constante évolution, qui la suivent de près.
Qu'avez-vous trouvé à Kiev?
La situation à Kiev est surréaliste et difficile à comprendre si vous ne l'expérimentez pas directement. Le centre est complètement désert. Dans les rues, il n'y a pratiquement que des journalistes et des militaires. Dans ce silence apparent, on entend le bruit incessant des explosions et des décharges de mitrailleuses en provenance des faubourgs.
Auriez-vous pu vous déplacer seuls?
L'interprète était fondamental. Emiliano et moi parlons anglais et plusieurs autres langues. La compréhension écrite et orale de l'ukrainien est essentiellement impossible pour quelqu'un qui ne le parle pas. Beaucoup de gens en Ukraine ne parlent pas anglais ou le parlent très mal. Parfois, il est même difficile d'expliquer simplement au chauffeur du taxi où vous voulez aller.
Avez-vous rencontré des difficultés particulières?
Un aspect très important à apprendre à gérer est certainement la relation avec l'armée et la police. Vous apprenez également à vous comporter aux check-points. Puis, au fil des jours, vous comprenez ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas filmer. Nous avons eu quelques épisodes où la police n'était pas contente que nous tournions avec notre caméra.
Comment avez-vous géré ces situations?
Nous avons toujours réussi, de manière très diplomatique, à calmer les esprits. L'autorisation officielle d'opérer dans les territoires contrôlés par l'armée, obtenue près des forces armées ukrainiennes, nous a également aidés, plus d'une fois et de manière décisive. En montrant cette accréditation, les agents ou soldats se détendaient un peu.
Mais l'accréditation officielle n'a pas toujours suffi...
Cela n'a pas toujours été facile. À Lviv, par exemple, nous avons commencé une émission en direct sur RSI quelques minutes après le début du couvre-feu dans la ville, fixé à 22h heure locale, 21h en Suisse. Même si nous n'étions qu'à trois mètres de l'entrée de notre hôtel, des agents armés de Kalachnikov sont immédiatement arrivés pour nous arrêter. Pour gagner du temps, comme Emiliano parlait déjà aux téléspectateurs en répondant aux questions du collègue sur le plateau en Suisse, j'ai montré à la police tous les types de documents que j'avais. En dernier lieu, pour gagner les deux minutes nécessaires pour terminer l’émission, je suis monté dans ma chambre chercher d'autres documents et leur ai même montré la carte d'assurance maladie et de fidélité d'un supermarché. Au final, ça s'est bien passé.
Qu'est-ce que vous n'étiez pas autorisé à filmer et pourquoi?
Les check-points et les installations militaires ne sont jamais filmés ! C'est une règle essentielle. En fait, peu de vidéos de telles installations militaires sont vues. Ceci afin de ne pas fournir d'informations sensibles relatives à la position de l'armée et aux structures de défense utilisées. D'un point de vue journalistique, il faut aussi dire qu'ils ne sont pas très intéressants. Il est également interdit de filmer les zones touchées par les missiles immédiatement après le bombardement. Ceci afin de ne pas donner à l'ennemi des informations sur les cibles qui ont été touchées ou non. Cependant, nous avons connu des situations dans lesquelles la police nous a permis de filmer, demandant de diffuser le matériel au plus tôt trois heures après l'événement.
Que pourriez-vous filmer librement?
Il y a eu une belle collaboration entre l'armée et la police pour filmer les zones déjà bombardées. Une collaboration presque excessive. Mais c'est en partie compréhensible. Les Ukrainiens souhaitent vivement que la communauté internationale sache ce qui se passe dans leur pays. Ce qu'ils subissent.
Leur attitude pourrait-elle influencer les journalistes?
La tâche du journaliste est de raconter sa perception des faits sans se laisser influencer. Être là pour nous est un privilège inestimable. Nous ne sommes pas allés au front. Mais nous avons vu un aperçu de la réalité de la guerre. C'est le témoignage le plus fort que nous puissions rendre. Et la plus grande difficulté de notre travail est de le ramener à ceux qui ne sont pas présents. Les images et les histoires peuvent aider, mais cela reste une approximation de la réalité. Quant aux événements précis dont nous n'avons pas été les témoins directs, pour vérifier il est important de croiser les sources et de faire une analyse. Quand je lis que les faits de Bucha sont tous un canular, je me mets très en colère, car cela signifie que le travail des journalistes sérieux est mis au même niveau que ceux qui inventent des mensonges juste pour crier au complot. L'incapacité d'une partie de la population à évaluer la qualité de sa propre source d'information est très inquiétante.
À propos des civils. Nous constatons que beaucoup de ceux qui fuient emmènent des animaux de compagnie avec eux. Ce sont des images inhabituelles, qui ne proviennent pas d'autres zones de guerre, comme la Syrie ou la Libye. Un signe que ce conflit est différent ? Pensez-vous que c'est une différence culturelle?
Pour ceux qui s'échappent à pied en quittant leur maison, peut-être pour toujours, il est inévitable de devoir choisir quoi emporter et quoi laisser. Je n'ai pas assez d'expérience sur le terrain pour pouvoir dire que cette guerre est différente des autres. Toutes les guerres ont en commun le fait que des gens tuent d'autres personnes. Il n'y a aucune humanité dans cette conception.
Gino Strada, fondateur de l’ONG Emergency, qui aide les blessés dans les conflits du monde entier, décédé il y a quelques mois, a déclaré que 90% des victimes de toute guerre sont des civils. Avez-vous eu la même impression?
Tout d'abord, nous devons nous mettre d'accord sur le concept de victime. Car la tragédie de la guerre va bien au-delà du nombre de morts. Nous avons tous vu des images de ce qui s'est passé à Marioupol, à Irpin, à la gare de Kromatorsk. L'Ukraine compte 44 millions d'habitants, plus de 10 millions ont fui leur foyer à ce jour. Il n'y a pas grand-chose à ajouter.
En tant que réalisateur, vous travaillez avec des images. Lesquelles vous allez retenir?
Celles des bâtiments détruits, des funérailles des soldats tués, des dépôts de carburant en feu sous nos yeux. On a l'habitude de les voir à la télé. Mais l'expérimentation à la première personne est une tout autre affaire.
Y en a-t-il d'autres?
Oui, ceux vus à Lviv de trains remplis de personnes en fuite et ceux de femmes et d'enfants qui, avec des sacs de fortune, ont traversé la frontière à pied. Tous ces gens avaient leur propre sang-froid. Toutes avec des expériences tragiques. Et toutes n'ont pas voulu les raconter. La chose indélébile qui restera gravée en moi à jamais : la peur dans les yeux de certains d'entre eux. Une chose clairement intelligible. Les mots? Inutiles, j'ai vu l'horreur dans leurs yeux.
Sur le plan humain, qu'allez-vous ramener personnellement de cette expérience?
La réponse à cette question est difficile pour moi. Certainement le renforcement de la prise de conscience de l'importance d'être les témoins directs de ce qui se passe dans ces contextes.
Vous avez donc eu des journées de travail très chargées, en plus du fait qu'elles se sont déroulées dans un contexte de guerre.
Oui, je peux raconter une anecdote qui pourrait même vous faire sourire. Nous avons très peu mangé pendant notre séjour en Ukraine, mais pas parce que nous manquions de nourriture. Nous l'aurions trouvé sans trop de difficulté. Mais parce que le temps des pauses était très limité. À la base nous sommes sur le terrain pour recueillir des témoignages et nous essayons d'en recueillir le plus possible afin d'avoir un portrait de la situation le plus précis possible. Dans ces conditions, l'appétit s’est un peu perdu. Les journées commençaient à 7h30 du matin et pouvaient se terminer même après 22h.
Votre collègue Emiliano Bos vient du monde de la radio. Comment étaient vos relations? Ça ne doit pas être facile de travailler plusieurs jours d'affilée, autant d'heures par jour, dans des conditions objectivement difficiles, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas bien et qui vient d'un autre media.
La collaboration avec Emiliano est un autre aspect professionnel très constructif que je retiens. Car la différence dans une circonstance comme la guerre est faite par la synergie qui lie les deux personnes qui travaillent ensemble. Nous nous sommes bien entendus et notre travail d'équipe a certainement été l'aspect gagnant de nos 18 jours ensemble.
Est-ce à dire que, malgré le stress, la fatigue et la situation difficile, tout s'est toujours bien passé? C'est difficile à croire.
Vous avez raison. Il y a eu des occasions où nous avons eu des discussions très animées. Mais en même temps, elles étaient très constructives car elles visaient à améliorer la qualité du produit final. Une fois les discussions terminées, nous avons continué le travail comme si de rien n'était. Je crois qu'un professionnel ne peut pas demander plus lorsqu'il collabore avec un collègue.
Etant donné les journées chargées, avez-vous pu maintenir le contact avec le monde extérieur?
Nous essayions de rester informés, mais le peu de temps disponible est consacré à la collecte d'informations sur le terrain et à la planification des déplacements. Sauf pour le travail, j'ai passé très peu d'appels en Suisse. Quelques messages aux amis et à la famille pour dire que tout allait bien, mais rien de plus.
Compte tenu de la positivité de l'expérience, envisagez-vous de réorienter votre carrière de réalisateur vers davantage de missions à l'étranger, dans des situations conflictuelles?
Réorienter n'est pas le bon mot. Le métier de réalisateur est un métier dans lequel les aspects pratiques vous façonnent beaucoup. En ce sens, grâce à l'expérience acquise en Ukraine, j'affronterai les futurs défis d'une manière différente, car chaque jour nous sommes appelés à plus de flexibilité, à être plus polyvalents.
Mais alors vous n’allez pas retourner en Ukraine?
En privé, j'y retournerai certainement, mais je ne sais pas quand. Pour le travail, il y a la volonté d’y aller, mais ce ne sont pas des décisions que je peux prendre de manière autonome.
Qu'avez-vous pensé lorsque vous avez quitté Lviv pour retourner en Suisse?
Je suis parti avec une seule certitude: en Ukraine il y a encore tant d'histoires à raconter.