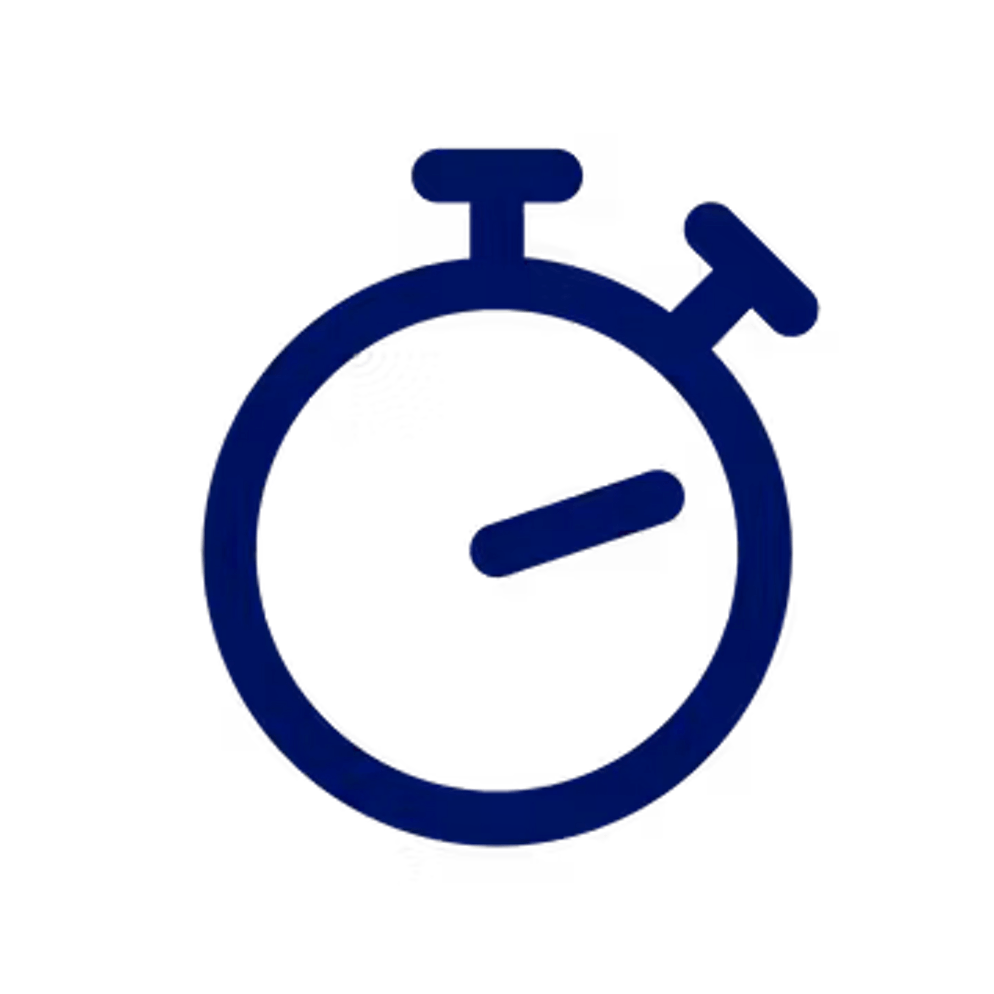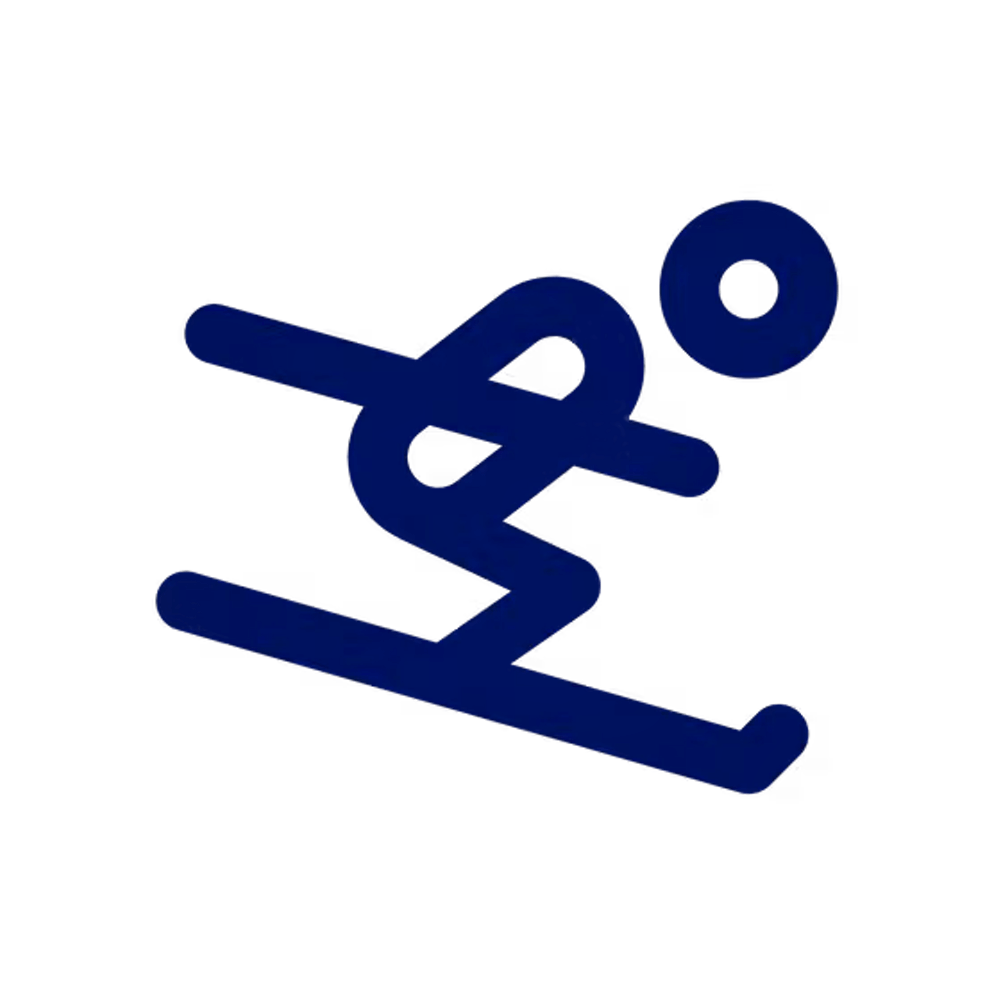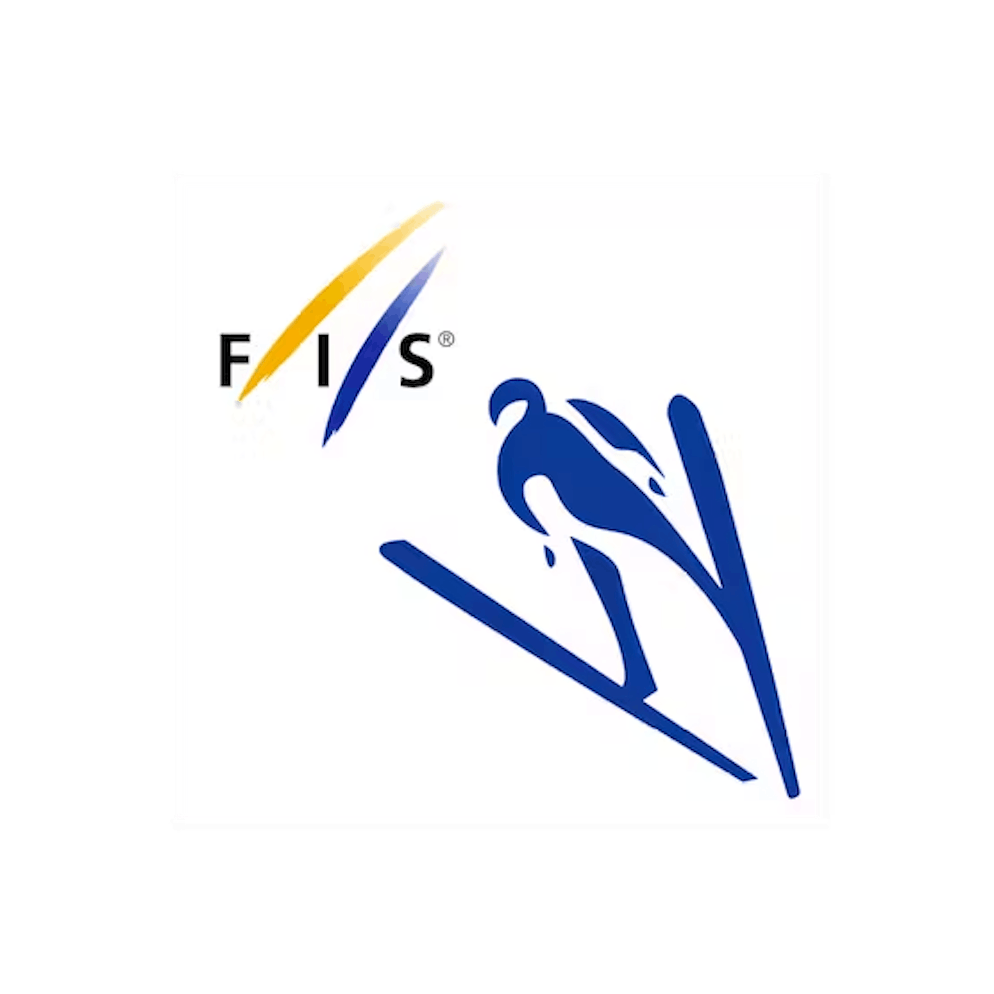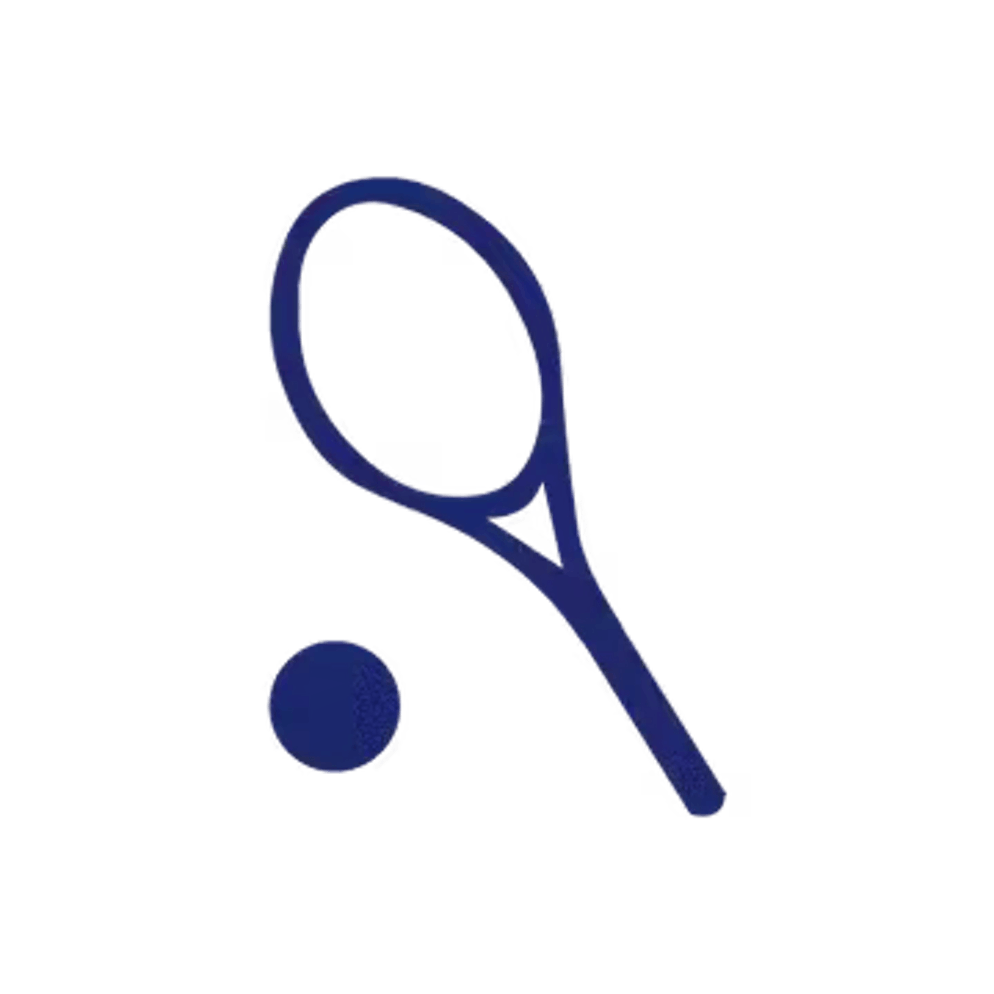Aperçu
Football en direct
Ligues
Super League
Aperçu
Sports d'hiver en direct
Résultats et classements FIS
Résultats et classements IBU
Aperçu
Hockey sur glace en direct
Résultats et tableau
Aperçu
Live-Tennis
Tournois
Résultats
Aperçu
Live Motorsport
Courses et classements
Services
Swisscom
- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Aide à la fin de vie Dr Tanja Krones: «Mourir n’est pas nécessairement catastrophique»
Jürg Wiler
28.1.2019

Tanja Krones doit souvent traiter des demandes de patients souffrant de maladies incurables. En tant que médecin et présidente de la commission d’éthique clinique de l’hôpital universitaire de Zurich, elle conseille les praticiens, les patients ainsi que les proches devant faire face à des difficultés existentielles considérables, notamment l’aide à la fin de vie.
Dr. Krones, de quoi s’occupe une commission d’éthique?
En Suisse, lors des quinze dernières années, ce genre de structure spécialisée a commencé à voir le jour dans la plupart des hôpitaux universitaires, dans certains hôpitaux régionaux de moindre envergure et dans des centres de soins. Son rôle est d’épauler l’équipe de traitement, les patients et les proches lors de problèmes et de dilemmes moraux. La commission d’éthique peut aussi intervenir à l’occasion de litiges, lorsqu’il s’agit de trouver la meilleure solution possible. L’éthique clinique accomplit trois tâches principales: premièrement, la formation continue de l’équipe de traitement; deuxièmement, le soutien dans les situations difficiles, ici il faut noter que ce n’est pas la commission elle-même qui tranche, elle tente plutôt de ménager un équilibre, de transmettre des informations et de faciliter le processus; troisièmement, elle doit élaborer des lignes directrices en matière d’éthique, au niveau national et international.
Quelles sont les questions les plus difficiles auxquelles vous devez répondre?
Fréquemment, il s’agit de résoudre des problèmes liés à l’équité. Par exemple, nous disposons d’une caisse d’assurance maladie obligatoire, mais elle souffre de lacunes. Ainsi se pose la question suivante: comment gérer les patients qui ne payent pas leurs primes d’assurance? Quelle solution adopter lorsque l’hôpital contracte des dettes? Nous devons également traiter les problèmes relatifs aux pénuries ou aux surplus.
Combien de cas la commission traite-t-elle par an? Quelle est la tendance?
Notre équipe bicéphale traite un peu moins de 1000 cas par an en collaboration avec le chargé d’éthique de chaque département de l’hôpital universitaire. Lorsque j’ai pris mon poste il y dix ans, nous ne traitions que quinze cas. Depuis, ce nombre n’a cessé d’augmenter.
Que se passe-t-il lorsque l’équipe de traitement n’est pas unanime? Par exemple, si des cardiologues, des chirurgiens ou l’équipe soignante ont des positions différentes?
Naturellement, cela se produit souvent car les individus peuvent percevoir les choses différemment. Fréquemment, lorsqu’il s’agit de répondre à une question éthique, il n’y a pas de «bonne» ou «mauvaise» réponse. Souvent, il n’y a même pas de bonne réponse. L’incertitude fait partie intégrante de la médecine. C’est la raison pour laquelle il faut communiquer. Quelle expérience ou certitude vous pousse à opter pour telle solution? Comment en êtes-vous arrivés à une conclusion différente? Souvent, il s’agit de simplement de clarifier le flux d’informations. Il arrive régulièrement que la différence entre les pronostics résulte de valeurs différentes. Je m’explique: un médecin qui veut continuer à se battre aura tendance à embellir un pronostic, tandis qu’une praticienne pourra faire valoir que la qualité de vie n’est plus acceptable. C’est précisément cela qu’il faut clarifier.
«Les conflits sont très rares au sein de notre établissement.»
Les hôpitaux sont connus pour leurs hiérarchies strictes. En fin de compte, n’est-ce pas le médecin-chef qui a le dernier mot?
En effet, cette hiérarchie existe. Elle est aussi présente dans le contexte des soins infirmiers. Naturellement, elle dépend également de la composition du département concerné. Un grand hôpital universitaire aura toujours plusieurs approches différentes en son sein. Cela dépend toujours du ou de la chef(fe). Ainsi, certains départements font la part belle au travail en équipe, tandis que d’autres disposent de chefs plus classiques. L’âge n’est pas nécessairement un facteur. En outre, il faut évidemment prendre en compte la responsabilité qui pèse sur la direction de la division. Néanmoins, un nombre croissant d’équipes de traitement témoignent d’une bonne pratique interprofessionnelle. Les deux sont possibles.
La communication est absolument essentielle dans les situations difficiles. Quelle est votre perception de la culture du dialogue entre les médecins et les patients?
Mitigée. Elle pourrait être meilleure. Dans les faits, il s’agit d’un problème générationnel. Les médecins expérimentés sont fréquemment d’excellents communicants. Toutefois, dans certaines situations, les médecins cadres ne sont pas en mesure d’avoir une bonne conversation avec les patients. En matière de communication, ce sont souvent les étudiants en médecine qui sont les plus aptes à transmettre des mauvaises nouvelles ou à prendre une décision commune, et ce car ils ont travaillé sur ce thème intensivement lors de leurs études.
Votre institution essaye-t-elle de former les médecins aux conversations délicates?
Plusieurs facultés de médecine œuvrent déjà en la matière. L’université de Bâle le fait déjà au plus haut niveau. Toutefois, ce sujet cesse d’être abordé lors de la formation continue des médecins. À l’hôpital universitaire de Zurich, quelques projets pilotes sont en cours dans notre centre de simulation, en collaboration avec le centre de formation. Nous souhaitons faire partie des meilleurs sur la scène internationale. L’apprentissage de compétences en communication doit se faire tout au long de la vie, en effet ce sont des capacités qui peuvent être continuellement renforcées, à l’instar de celles des chirurgiens. Il existe de nombreux domaines pour lesquels il est possible de poursuivre l’apprentissage: les conversations complexes et ardues, les explications approfondies avec inclusion du patient, la planification collaborative avec le patient, les potentielles erreurs médicales et l’annonce de mauvaises nouvelles.

Lorsqu’on est en mesure de bien communiquer, moins de problèmes surviennent, y compris ceux d’ordre juridique. Cette prise de conscience semble se démocratiser. Toutefois, il faut absolument que l’État et les caisses d’assurance maladie financent la «médecine orale» autant que les médicaments onéreux.
Au sein de l’hôpital universitaire, de quelle façon informe-t-on les patients gravement malades ou en phase terminale de l’existence de l’aide à la fin de vie?
Les médecins mentionnent rarement ce thème eux-mêmes. Dans les hôpitaux suisses-allemands, il est courant que ce processus soit enclenché après que le patient l’a mentionné. Les médecins et les soignants ont également pour habitude de demander aux patients ce qui compte le plus pour eux. Pour ce faire, il faut une relation de confiance, qui doit être mise en place en amont. La réponse médicale appropriée est la suivante: «Je comprends votre demande et je ne veux pas en faire un sujet tabou. Je vais évaluer votre requête et je pourrai ensuite vous aider à prendre la décision qui vous convient.» En outre, il faut garder à l’esprit que nous avons la possibilité de communiquer des informations relatives à l’aide à la fin de vie, mais qu’aucun médecin n’est obligé de le faire. Il doit prendre cette décision lui-même.
Que faut-il garder à l’esprit?
Grâce au travail d’organisations comme EXIT, les citoyens disposent d’un accès direct à des informations justes. En revanche, il arrive fréquemment que les personnes concernées ignorent que la décision ne peut être validée que si le patient a toute sa capacité de discernement. La prise de conscience de ce facteur peut donner lieu à des situations chaotiques pour certains individus. Ils souhaitent alors bénéficier de l’accompagnement à la fin de vie aussi rapidement que possible. Une situation assez émouvante et triste, que nous essayons rapidement de tirer au clair. De surcroît, il faut que les individus qui souhaitent être aidés à mourir ne soient pas considérés comme suicidaires et ainsi catégorisés comme cas psychiatriques. Le cas échéant, il faut alors déterminer si l’intervention d’un psychiatre peut être utile. Il faut réellement examiner chaque cas en détail.
À l’instar de la grande majorité des hôpitaux suisses, l’hôpital universitaire de Zurich n’autorise pas l’aide à la fin de vie au sein de son bâtiment. Pourquoi?
Principalement car c’est une tâche qui incombe aux médecins. Souvent, il leur est personnellement difficile de simultanément sauver des vies et aider au décès, bien qu’ils puissent parfois comprendre le désir de bénéficier d’une assistance au suicide. Ainsi, le rôle de notre structure est d’aider l’équipe de traitement à ne pas se retrouver en situation conflictuelle. En outre, lorsque des personnes vivent dans des centres de soins (où un accompagnement est possible), il s’agit de leur espace privé, leur foyer. À l’hôpital, ce n’est pas le cas. Au fond, notre rôle est explicatif. En matière d’accompagnement à la fin de vie, il faut vraiment se demander si la décision a été bien mûrie et s’il ne subsiste pas d’autres solutions potentielles. Cependant, la situation peut rapidement se compliquer si la personne concernée ne peut pas être déplacée. En réalité, il est sans doute préférable de tout analyser au cas par cas.
Au sein de l’établissement, comment gérez-vous les patients qui souhaitent bénéficier d’une aide à la fin de vie?
Lorsqu’un homme ou une femme a vraiment réfléchi à cette question, nous ne bloquons pas le processus. Dans tous les cas, l’organisation EXIT peut rendre visite au patient afin de planifier un accompagnement. Ensuite, le patient peut directement être transféré à son domicile ou dans une structure dédiée à l’aide à la fin de vie. Nous remettons une lettre de sortie et laissons, en cas de besoin, un accès veineux. Nous ne délivrons pas directement le certificat qui prouve la capacité de discernement, ceci dépend du médecin actuel. Enfin, je tiens à souligner un point: c’est un sujet que nous abordons souvent, mais les conflits sont très rares dans notre établissement. Sur environ 1000 cas par an, la commission d’éthique ne doit traiter que trois ou quatre litiges.
«Lorsqu’une personne a longuement mûri sa décision, j’estime que l’accompagnement à la fin de vie est absolument compréhensible.»
Quel est votre avis personnel sur l’aide à la fin de vie?
Le suicide existe depuis la nuit des temps. D’un point de vue philosophique et éthique, ce n’est pas quelque chose que l’on peut condamner. Qu’est-ce qu’une mort digne? Je pense qu’il convient à chacun d’y réfléchir. Lorsqu’une personne a longuement mûri sa décision, j’estime que l’accompagnement à la fin de vie est absolument compréhensible. Ce qui est crucial, c’est d’apporter les soins nécessaires dans une telle situation. En outre, c’est une procédure qui demande énormément d’application. EXIT est dans l’obligation de fournir un service de qualité optimale et doit même chercher à l’améliorer en permanence.
Les directives anticipées des patients sont cruciales pour votre travail quotidien. Quand revêtent-elles le plus d’importance?
Les directives anticipées sont utiles lorsqu’elles sont représentatives des valeurs du patient et qu’elles ont été au préalable discutées avec un médecin ou un soignant. Le patient est censé planifier ce processus en collaboration avec une personne spécialisée. En anglais, on parle de Advance Care planning. Il faut également avoir une conversation avec les proches, afin de d’identifier leurs espoirs, angoisses et envies.
Selon vous, quel sont les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber?
Il ne faut pas être seul pour rédiger les directives anticipées. Par exemple, certains écrivent: «J’aime marcher dans la montagne et j’adore mes petits-enfants...» De telles informations ne sont pas utiles en cas d’urgence. Dans ce cas de figure, on se dit: «Alors, le patient ne pourra plus faire de la randonnée, mais il pourra toujours monter l’escalier. A-t-il envie de mourir?» Les médecins qui doivent gérer les directives anticipées doivent pouvoir fixer un objectif thérapeutique. Ce dont ils ont besoin, c’est une délimitation claire. Ainsi, il faut impliquer un spécialiste afin de poser les bonnes questions. Qu’est-ce qui est essentiel en cas de traitement d’urgence? Où se trouve la limite? Que doit-on absolument éviter?
Votre travail est relatif à des sujets difficiles, tels que le passage dans la mort et la mort. En subissez-vous certaines conséquences?
Je tiens à souligner que mourir n’est pas nécessairement un événement catastrophique. La mort peut aussi être belle. Particulièrement lorsque les membres de la famille parviennent à trouver leur paix intérieure. En outre, il s’agit ici de patients qui souffrent depuis de longues années et de familles souvent divisées, et ce tout au long de leur vie. Malgré ces conflits, il faut réussir à organiser des adieux. Chaque aide à la fin de vie doit être accomplie dans la dignité, pas seulement pour le patient, mais aussi pour les proches qui lui survivront. Dans les meilleurs cas, à la suite de la procédure, les proches estiment que le processus était cohérent, l’acceptent et poursuivent leur vie. Afin de rendre cela possible, il faut communiquer et réaliser un travail biographique, si cela est possible. En fin de compte, un arrêt cardiaque soudain peut faire figure de mort paisible, si l’on sait que c’était le souhait du patient. Les proches peuvent ainsi, en toute conscience, simplement tenir la main du patient dans ses derniers instants.
Cet entretien est paru dans un premier temps au sein de la revue de l’organisation d’aide à la fin «Exit».
Ces célébrités sont décédées en 2018

Charles Aznavour est mort le 1er octobre . Image d'archive datée du 21 mars 2013, prise à Fribourg.
Photo: Keystone

Jacques Higelin est décédé le 6 avril. Image d'archive datée du 8 mars 2008, lors d'un concert à Paris.
Photo: Keystone

Maurane nous a quittés le 7 mai.
Photo: Keystone

France Gall est décédée le 7 janvier. Image datée du 20 mars 1965 lors d'un concert à Naples, en Italie.
Photo: Keystone

Yvette Horner est décédée le 11 juin. Sur cette image d'archive, la musicienne se trouve sur scène le 8 décembre 1998 à Lausanne.
Photo: Keystone

Rachid Taha est mort le 12 septembre. Image du 29 juillet 2001, lors d'un concert à Nyon.
Photo: Keystone

La superstar de la musique Aretha Franklin est décedée le 16 août. Cette photo a été prise le 13 mars 1972.
Photo: Keystone

Le chef Paul Bocuse, le 24 mars 2011, devant son restaurant L'Auberge du Pont de Collonges à Collonges-au-Mont-d'or, en France. Il est décedé le 20 janvier.
Photo: Keystone

Le chef cuisinier Joël Robuchon lors de la Sirha International Hotel Catering and Food trade exhibition à Lyon (France) le 25 janvier 2017. Il est mort le 6 août.
Photo: Keystone